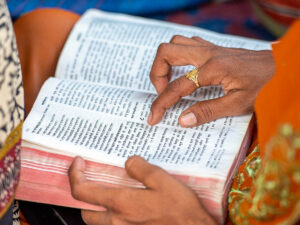Un missionnaire nommé François
 François, le pape missionnaire!
© Ad Extra
François, le pape missionnaire!
© Ad Extra
Rédigé par Gianni Criveller, PIME, le 25/04/2025
La proclamation de l’Évangile était sa priorité absolue : il nous a rappelé que la mission est une question de joie, que ses territoires ne sont pas définis par la géographie ou l’appartenance religieuse des gens. Par sa vie et son enseignement, il nous a appris que les missionnaires de Jésus ne se demandent pas comment amener les autres à les suivre, mais comment ils peuvent atteindre les autres.
François fut un pape missionnaire : en 12 ans de pontificat, il a visité 66 pays à travers le monde, ainsi qu’une cinquantaine de lieux en Italie. Une tâche impressionnante, compte tenu de son âge avancé et de sa santé fragile.
Les destinations choisies par le pape reflètent les orientations fondamentales de son pontificat depuis le 8 juillet 2013, lorsqu’il a visité l’île de Lampedusa, pour montrer au monde son souci pour la tragédie des migrations, et exprimer son indignation et sa douleur face aux massacres en Méditerranée.
Le pape s’est engagé dans un dialogue avec la Chine, concluant un accord historique ; il a rencontré Poutine et le patriarche Kirill de Moscou. Mais François n’a pas du tout favorisé les nations au centre des enjeux stratégiques de l’humanité.
Au contraire, il a attiré l’attention sur des pays, des communautés ecclésiales, des guerres et des conflits situés à la marge des grands débats et des récits médiatiques.
Le pape a voulu démontrer – et il y est parvenu – qu’il n’existe pas de pays ou de peuples plus ou moins importants, et que leur dignité ne se mesure ni à la taille de leur population, ni à leur influence économique ou politique.
Il s’est rendu au Timor oriental, en Birmanie, au Bangladesh, à Singapour, en Mongolie, au Sri Lanka, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Soudan du Sud, à l’île Maurice, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et dans bien d’autres lieux encore, dont beaucoup sont considérés comme inintéressants par ceux qui jugent les événements du monde à l’aune du pouvoir et des marchés.
L’annonce de l’Évangile fut sa priorité absolue : et la mission ne se mesure pas au succès mondain ou à l’obtention d’une majorité religieuse, mais à la qualité du témoignage évangélique. Il me semble que le pape a affiné une lecture évangélique de la réalité : la logique des Béatitudes renverse et subvertit celle du monde.
Le pape a souvent critiqué le prosélytisme, une contrefaçon de l’activité missionnaire, qui compte sur des moyens humains et la persuasion pour convaincre autrui de rejoindre notre groupe. En aucun cas, il n’a remis en cause l’importance de la Mission, comme certains ont pu le penser.
Au contraire, la mission n’est pas une œuvre humaine, et François l’a repensée à partir de sa source : elle vient de Dieu et le protagoniste en est l’Esprit de Jésus. Cette vision est importante, car la mission a parfois été portée par une pensée théologique mondaine et superficielle, se satisfaisant de bilans comptables et de succès gratifiants.
Quelle était la véritable valeur évangélique des conquêtes religieuses obtenues à partir de positions de pouvoir, avec des stratégies d’expansion coloniale ? La logique de l’Évangile, elle, fait confiance à ce qui est petit, fragile et caché, car c’est ainsi que se manifeste la grâce de Jésus.
À l’opposé du prosélytisme, François a rappelé que la mission se diffuse par attraction. C’est Jésus qui attire à lui, et c’est le témoignage évangélique authentique de ses disciples qui donne envie aux gens de Le suivre.
Si la mission est un don de Dieu, si elle est l’oxygène de la vie chrétienne, son sens est profondément renouvelé avec l’enseignement de François. La mission est liée à la joie ; elle est une bonne nouvelle qui apporte bonheur et beauté. La joie de l’Évangile est le titre de sa première exhortation apostolique, le programme et la charte de son pontificat.
L’Évangile est quelque chose de beau qui apporte du bonheur dans la vie des gens. Les communautés chrétiennes et les disciples qui manifestent tristesse, déception, découragement ou ennui ne pourront jamais attirer à Jésus.
La prédication de l’Évangile ne peut pas se faire dans l’opposition aux autres religions, dans la peur de Dieu ou des autres, ni se fonder sur des doctrines menaçant de punitions, nourrissant culpabilité, frustration et rébellion.
Nous devons être heureux d’être disciples de Jésus et des missionnaires de son Évangile! Le pape fait repartir la vie chrétienne et la mission à partir de la joie, qui est l’émotion de la nuit de Noël et du matin de Pâques.
Le pape a également montré que les lieux de mission ne sont pas seulement définis par la géographie ou par l’appartenance religieuse des personnes.
Ces nouveaux lieux ont été décrits avec des images frappantes et concrètes : Église en sortie, hôpital de campagne, périphéries… Si je comprends bien le pape François, la mission ne consiste pas tant à faire venir davantage de personnes à l’Église qu’à envoyer les membres de l’Église vers les lieux où se trouvent les femmes et les hommes d’aujourd’hui, leur offrant solidarité, aide et soin.
Les missionnaires de Jésus ne se demandent pas comment amener les autres à les suivre, mais comment aller à leur rencontre.
L’image de l’hôpital de campagne est particulièrement saisissante en cette période marquée par les guerres, les blessés et les plaies à soigner : la mission s’adresse aux tragédies des hommes et des femmes de notre temps.
C’est là que les disciples missionnaires réalisent l’Évangile de paix et de liberté, de miséricorde et de soin, à l’imitation de Jésus, le Bon Samaritain.
Le soir où il s’est présenté au monde, le pape François a décrit son pays d’origine, l’Argentine, comme étant situé « presque au bout du monde ».
Mais il a lui-même démontré qu’aucun pays n’est au bout du monde. Pour qui regarde l’humanité avec le regard de Jésus, aucun lieu, aucune personne n’est trop éloigné.
P. Gianni Criveller, PIME
Traduction de l’article : https://www.asianews.it/news-en/A-missionary-named-Francis-62934.html