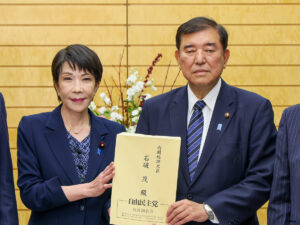Le Népal agité par un appel au retour de la monarchie
 Le musée du palais Narayanhiti (ancien palais royal du Népal), à Katmandou.
© Kp217c / CC BY-SA 4.0
Le musée du palais Narayanhiti (ancien palais royal du Népal), à Katmandou.
© Kp217c / CC BY-SA 4.0
Le 07/04/2025
La nation himalayenne a aboli sa monarchie hindoue en 2008, mais la montée d’un mécontentement populaire face au gouvernement ravive les appels en faveur de son rétablissement. Le Népal est aujourd’hui le théâtre de manifestations pro-monarchiques d’une ampleur sans précédent depuis 2008. Ces rassemblements, qui ont dégénéré en violences fin mars, mêlent nostalgie royale et aspirations nationalistes. La résurgence de ce sentiment met en lumière les fragilités d’un pays en quête d’unité politique, de développement économique et de stabilité institutionnelle.
Depuis quelques années, des groupes pro-monarchistes réclament le retour de l’ancien roi Gyanendra Shah, dernier souverain du Népal, déchu en 2008 lors de l’abolition de la monarchie. Leur projet entend restaurer une monarchie constitutionnelle garante de l’unité nationale et de la stabilité politique. Le 29 mars 2025, cette revendication a viré à la confrontation. À Katmandou, une manifestation organisée par le Rastriya Prajatantra Party (RPP), principal parti royaliste, a dégénéré. Des centaines de manifestants se sont rassemblés près du Parlement, où des affrontements violents ont éclaté, avec des véhicules et des magasins vandalisés. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Les heurts ont fait deux morts, alors que 40 protestataires et 30 policiers ont été blessés.
Le gouvernement a aussitôt condamné les violences. « Si quelqu’un tente de freiner les progrès du pays ou le cours du temps, cela ne sera pas toléré », a averti le Premier ministre népalais KP Sharma Oli. Le principal leader de l’opposition et chef du Parti communiste du Népal (Centre maoïste), Pushpa Kamal Dahal, a quant à lui déclaré que toute tentative de rétablir la monarchie minerait les acquis républicains du Népal.
De leur côté, les royalistes dénoncent un gouvernement incapable de répondre aux aspirations populaires. « Le peuple est déçu par les promesses trahies de la République. Nous ne demandons pas l’autoritarisme, mais une monarchie constitutionnelle stable, à l’image d’autres démocraties en Asie », a affirmé Rajendra Lingden, le leader du RPP.
Seize ans après l’abdication du dernier roi, le bilan est mitigé
Pris en étau entre la Chine et l’Inde, le Népal est une petite nation himalayenne de 30 millions d’habitants. La monarchie y a été abolie en 2008, à l’issue d’une décennie d’une insurrection maoïste qui a fait plus de 17 000 morts. Lancée en 1996, l’insurrection maoïste visait à renverser la monarchie et instaurer une république populaire. Le conflit a profondément bouleversé la société, exacerbant les inégalités sociales, ethniques et régionales. En 2006, un accord de paix a mis fin aux combats et ouvert la voie à une transition démocratique, appuyée par des manifestations géantes contre le régime autocratique du roi Gyanendra.
En 2008, le roi Gyanendra, dernier souverain d’un royaume hindou fondé en 1769, a été contraint d’abdiquer. La République naissante promettait alors une nouvelle ère, fondée sur la justice sociale, l’équité et le développement. Mais seize ans plus tard, le bilan est mitigé. Le pays a vu se succéder quatorze gouvernements, connaît des blocages institutionnels chroniques, une instabilité politique persistante et une croissance économique fragile. En quête d’un emploi, des millions de Népalais ont migré vers d’autres pays. Le passage de la monarchie à la démocratie sous un système fédéral a conduit le Népal à être divisé en provinces bénéficiant d’un certain degré d’autonomie, mais cette réorganisation a engendré de fortes tensions ethniques et régionales.
Dans ce contexte, le soutien à la restauration de la monarchie et d’un État hindou s’est récemment accru, en appelant au retour du roi Gyanendra. L’homme était monté sur le trône à la suite d’une tragédie, surnommée « le massacre du palais ». Un soir du 1er juin 2001, son frère, le roi régnant Birendra, et une grande partie de la famille royale ont été tués dans le palais de Narayanhiti, à Katmandou. Le prince héritier Dipendra avait ouvert le feu lors d’un dîner familial, tuant son père, le roi Birendra, sa mère, la reine Aishwarya, ainsi que huit autres membres de la famille royale, avant de retourner son arme contre lui.
C’est ainsi que Gyanendra, absent du palais ce soir-là, a accédé au trône. Cette tuerie reste l’un des épisodes les plus traumatisants et énigmatiques de l’histoire récente du Népal. L’enquête officielle a conclu à un geste motivé par un différend familial, suscitant des doutes et des théories du complot parmi la population. Ce massacre a précipité une période d’instabilité profonde, précédant l’abolition de la monarchie sept ans plus tard.
Pourquoi un tel regain d’allégeance à la monarchie ?
Pourquoi, aujourd’hui, un tel regain d’allégeance à une monarchie longtemps perçue comme décadente, après le chemin ardu parcouru par le Népal pour devenir une démocratie et se doter d’une nouvelle Constitution ? La désillusion politique est au cœur de ces évolutions. En seize ans, quatorze gouvernements se sont succédé, dans un jeu constant d’alliances et de mésalliances, laissant place à une instabilité chronique, des blocages institutionnels, une corruption endémique et des promesses non tenues. Cette situation engendre un sentiment de frustration et de nostalgie et le roi, pour certains, est devenu le garant de la stabilité et de l’unité. Dans les manifestations pro-monarchiques, le slogan « Ram, Raja, Rashtra » (Dieu, Roi, Nation) illustre cette quête.
En février dernier, les militants pro-monarchistes ont commencé à se mobiliser. À 77 ans, l’ancien roi, qui s’était abstenu de tout appel à la restauration de la monarchie, a pris une posture plus affirmée. Dans une vidéo, Gyanendra a ainsi déclaré : « Il est temps maintenant. Si nous voulons sauver notre nation et maintenir l’unité nationale, j’appelle tous les compatriotes à nous soutenir pour la prospérité et le progrès du Népal. »
Le débat sur l’identité culturelle et religieuse nourrit également cette cause. Le Népal, royaume hindou jusqu’en 2008, a été déclaré État laïc avec l’adoption de la nouvelle Constitution. Cette rupture continue de diviser, dans un pays marqué par sa diversité religieuse. L’hindouisme, pratiqué par environ 80 % des Népalais, est dominant, tandis que le bouddhisme, notamment tibétain, occupe une place importante, surtout dans les régions montagneuses. L’islam et le christianisme sont également présents, tandis que de nombreuses communautés suivent des croyances animistes ou traditionnelles, dans une pluralité religieuse qui façonne la culture et la société népalaise.
Des tensions profondes entre modernité politique et traditions culturelles
Pour les militants pro-monarchiques, l’attachement aux traditions hindoues est central, et le roi en est le garant naturel. L’idée de son retour incarne un espoir de reconquête spirituelle autant que politique. Certains leaders de ce mouvement puisent dans ce discours identitaire pour justifier leur appel à la restauration de la royauté.
Enfin, la montée du nationalisme hindou en Inde, porté au pouvoir par le Bharatiya Janata Party (BJP) depuis 2014, entraîne des répercussions directes sur le Népal. Certaines figures politiques indiennes proches du pouvoir ont publiquement soutenu l’idée d’un retour à un État hindou au Népal, ce qui renforce les discours pro-monarchiques et les revendications identitaires. Lors des récentes manifestations à Katmandou, des partisans de l’ancien roi ont brandi une bannière avec une photo de Yogi Adityanath, moine hindou radical et dirigeant de l’Uttar Pradesh, État frontalier du Népal, dont le temple historique de Gorakhpur est lié à la royauté népalaise. La résurgence monarchiste au Népal peut ainsi compter sur le soutien des groupes hindous fondamentalistes en Inde.
Dans l’immédiat, cette situation complexe met en lumière les profondes tensions entre modernité politique et traditions culturelles, tout en soulignant l’impact des dynamiques régionales sur la politique intérieure népalaise. Surtout, elle menace de déstabiliser davantage le pays, risquant de compromettre la paix et le développement auxquels aspire la population népalaise.
(Ad Extra, A. B.)