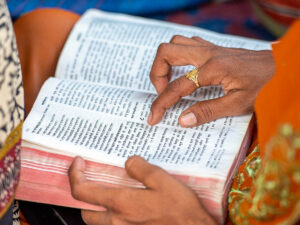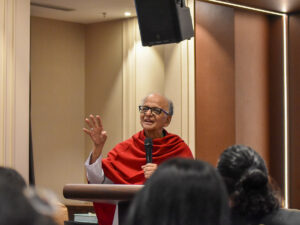Femmes et pouvoir en Asie-Pacifique : cartographie 2025
 La future Première ministre japonaise Sanae Takaichi, ici en décembre 2024 avec le Premier ministre sortant Shigeru Ishiba, démissionnaire tout juste un an après son entrée en fonction.
© Government of Japan / CC BY 4.0
La future Première ministre japonaise Sanae Takaichi, ici en décembre 2024 avec le Premier ministre sortant Shigeru Ishiba, démissionnaire tout juste un an après son entrée en fonction.
© Government of Japan / CC BY 4.0
Le 13/10/2025
L’arrivée de la conservatrice japonaise Sanae Takaichi, élue le 4 octobre à la tête du parti PLD et aux portes du pouvoir, survient un mois après la nomination de Sushila Karki au Népal, et un an après celle de Harini Amarasuriya au Sri Lanka. Dans ce contexte, le géopolitologue Olivier Guillard propose une réflexion sur la faible représentation des femmes au pouvoir en Asie-Pacifique, avec des échecs comme Sheikh Hasina (Bangladesh) et Paetongtarn Shinawatra (Thaïlande) mais aussi des réussites comme Tsai Ing-wen (Taïwan), sans oublier le sort d’Aung San Suu Kyi, toujours considérée comme l’égérie de la démocratie en Birmanie.
D’ici le 15 octobre, un mois après Sushila Karki au Népal, et un an après Harini Amarasuriya au Sri Lanka, l’Asie-Pacifique devrait élargir un peu plus le cercle encore trop restreint des femmes politiques accédant aux fonctions de cheffe de gouvernement. Ce club limité s’apprête à intégrer Sanae Takaichi, qui vient d’être élue le 4 octobre à la tête du parti conservateur PLD (Parti libéral-démocrate), longtemps tout-puissant. Techniquement, cette nomination ouvre largement les portes à sa désignation, mi-octobre par le Parlement, comme successeure au Premier ministre sortant Shigeru Ishiba, démissionnaire tout juste un an après son entrée en fonction.
La future « dame de fer » de l’archipel, aux convictions conservatrices bien trempées, à l’opiniâtreté démontrée, n’aura guère la tâche facile. La feuille de route domestique (économie, crise de confiance de l’électorat, montée du populisme dans l’archipel, vieillissement de la population) et sa déclinaison extérieure (relations fragilisées avec les États-Unis, crispées avec la Chine[1], la Russie[2] et la Corée du Sud[3] ainsi qu’avec la Corée du Nord) risquent fort d’éprouver sa détermination et les aptitudes de son futur cabinet.

Les défis de la nouvelle Première ministre népalaise
Cette configuration intérieure et étrangère volatile la rapproche du sort qui attend son homologue népalaise Sushila Karki, Première ministre par intérim depuis que la colère, l’exaspération de la génération Z et la violente répression des forces de l’ordre (sans oublier une gouvernance éreintante ces dernières décennies entre médiocrité et indécence) ont chassé début septembre l’ancien chef de gouvernement KP Sharma Oli (12e chef de gouvernement depuis 2008…).
L’intégrité et la réputation de l’ancienne Présidente de la Cour Suprême (deux qualités combinées fort rares dans le très opaque microcosme politique de l’ancien royaume hindou himalayen) ont plaidé en faveur de sa nomination. Cette septuagénaire alerte sera chargée d’assurer au mieux les affaires courantes jusqu’à l’organisation d’un énième scrutin législatif national au printemps prochain (mars 2026). Dans cette effervescente jeune république (depuis 2008), ce défi ne saurait être aisé à relever.
Sri Lanka, Inde, Îles Marshall
Au niveau régional (en Asie du Sud), Mme Karki pourrait peut-être trouver quelque soutien et inspiration de la part de sa consœur Première ministre sri-lankaise, Mme Harini Amarasuriya, cheffe de gouvernement post-chaos[4] (et 3e femme seulement à se voir confier ces fonctions dans l’île) depuis fin septembre 2024.
Une Première ministre discrète, peu connue du grand public (plus encore de l’Occident), du fait notamment qu’en République démocratique socialiste du Sri Lanka, prévaut un régime présidentiel réservant au chef de l’État la véritable autorité politique (au profit depuis l’été 2024 du président Anura Kumara Dissanayake).
À l’approche de cette fin d’année 2025, la vaste, diverse et complexe région Asie-Pacifique compte également deux Cheffes d’État : en Inde tout d’abord, avec Mme Droupadi Murmu (en poste depuis juillet 2022). Comme ses prédécesseurs, la 15e présidente de la « plus grande démocratie du monde » assure essentiellement des fonctions protocolaires et cérémoniales, laissant dans les faits la gestion des affaires de la 4e économie mondiale à un Premier ministre (Narendra Modi, en poste depuis 2014).
À quelque 10 000 km de New Delhi vers l’est, dans le lointain et insulaire Pacifique Sud, la présidente indienne Droupadi Murmu compte une homologue en la personne de Mme Hilda Heine, présidente (pour la 2e fois) de la République parlementaire des Îles Marshall (180 km², 39 000 habitants), et première femme de toute la Micronésie à accéder à cette haute fonction (lors de son premier mandat en 2016).

Des fins de mandats houleuses à Bangkok et Dacca
À Katmandou, Colombo ou Tokyo, le trio de cheffes de gouvernement en exercice (ou sur le point de l’être pour Mme Takaichi) aspire sûrement à un exercice du pouvoir moins heurté que ne le furent récemment, en Thaïlande et au Bangladesh, les fins de mandats précipitées et houleuses de leurs homologues.
Tout d’abord celui de Mme Paetongtarn Shinawatra, il y a quelques semaines à peine, fin août à Bangkok. Et bien sûr la chute à Dacca de la Première ministre Sheikh Hasina (78 ans), enkystée au pouvoir durant deux interminables décennies (jusqu’en août 2024) au prix d’une gouvernance décriée (népotisme, autoritarisme, corruption, clientélisme), et poussée vers la sortie par la colère de la rue (et depuis lors réfugiée en Inde).
Des exemples de gouvernance du côté de Taipei et Wellington
Fort heureusement pour les Premières ministres en exercice dans la région Asie-Pacifique, il se trouve aussi quelques exemples récents de réussite parmi leurs consœurs dans l’exercice de leurs responsabilités. Des expériences qui se sont terminées sur des notes moins houleuses ou brutales que pour Mme Hasina (Bangladesh) et P. Shinawatra[5] (Thaïlande), à rechercher plus précisément du côté de Taipei (Taïwan) et de Wellington (Nouvelle-Zélande).
Dans l’excentrée mais si extraordinaire « terre du long nuage blanc » (le nom maori pour la Nouvelle-Zélande ; 270 000 km² pour 5,3 millions d’habitants), Mme Jacinda Ardern (45 ans) a occupé le poste de 40e Première ministre entre 2017 et 2023. Une dirigeante énergique, appréciée et charismatique, préférant à la surprise générale céder d’elle-même le pouvoir plutôt que de s’y user[6] : « J’ai tout donné pour être première ministre, mais cela m’a aussi beaucoup coûté […]. Je n’ai tout simplement plus assez d’énergie pour quatre ans supplémentaires »[7].

À Taipei, dans « l’île rebelle » faisant face à la République populaire de Chine, une autre authentique dame de fer a longtemps tenu la dragée haute à Pékin : la présidente Tsai Ing-wen, aux deux mandats bien remplis. Entre 2016 et 2024, elle a affronté sans jamais baisser les yeux l’ire permanente et les défiances pékinoises répétées (cf. les manœuvres militaires massives enserrant l’île, la guerre hybride, la tactique de la zone grise au quotidien, les cyberattaques, les menaces rhétoriques pas même voilées, etc.). Il y a là une possible source de résilience et d’inspiration pour les cheffes de gouvernement et autres présidentes en fonction en Indopacifique.
Le sort de l’égérie birmane de la démocratie
Il serait déplacé de disserter sur la place – infiniment sous-représentée – des femmes de pouvoir dans cette région du monde sans évoquer le sort difficile d’Aung San Suu Kyi. L’égérie birmane de la démocratie, ancienne présidente de facto entre 2016 et fin janvier 2021, a été boutée sans ménagement ni égard hors du pouvoir le 1er février 2021 par des généraux avides d’autorité et hostiles à la règle démocratique.
Depuis, malgré son aura populaire, son âge avancé (80 ans) et une santé fragilisée par les conditions spartiates de sa détention, elle est embastillée par la junte en un lieu tenu secret, privée de tout contact depuis près de cinq ans avec ses proches. Dans une indifférence extérieure consternante…
(Ad Extra, Olivier Guillard)
[1] Au sujet – entre autres thématiques bilatérales disputées – des ambitions territoriales chinoises en mer de Chine de l’Est.
[2] Différend territorial sur les îles Kouriles, différend diplomatique relatif à l’invasion des forces russes en Ukraine.
[3] Passé colonial nippon dans la péninsule coréenne (1910-1945).
[4] À l’été 2022, un tsunami populaire avait en peu de temps fait vaciller le pouvoir et chasser de Colombo sans ménagement la dynastie politique Rajapaksa.
[5] 11 ans plus tôt, au printemps 2014, son élégante tante Yingluck Shinawatra, alors première 1ère ministre du royaume (elle aussi, depuis 2011), connaissait pareillement une fin de mandat précipitée, sur décision de la Cour constitutionnelle.
[6] Jacinda Ardern, Un autre art du pouvoir, Flammarion, Paris, juin 2025.
[7] Le Monde, 19 janvier 2023.