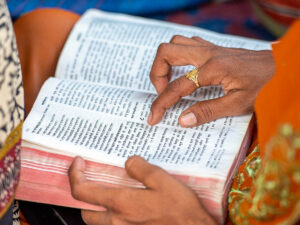La liberté religieuse est de plus en plus attaquée en Asie
 La cathédrale Notre-Dame de Saïgon, Vietnam. Le rapport de l’AED note qu’en Asie, « l’expression religieuse est de plus en vue comme une menace envers la sécurité de l’État ou l’identité nationale ».
© Diego Delso / CC-BY-SA 3.0
La cathédrale Notre-Dame de Saïgon, Vietnam. Le rapport de l’AED note qu’en Asie, « l’expression religieuse est de plus en vue comme une menace envers la sécurité de l’État ou l’identité nationale ».
© Diego Delso / CC-BY-SA 3.0
Le 24/10/2025
La liberté religieuse s’est fortement détériorée à travers l’Asie : les contrôles autoritaires, le nationalisme ethnoreligieux et les violences extrémistes se sont intensifiés, selon le rapport 2025 sur la liberté religieuse dans le monde publié le 21 octobre à Rome par l’Aide à l’Église en Détresse. L’Inde, la Chine et la Corée du Nord figurent parmi les pays les plus affectés. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a accueilli le rapport en rappelant que la liberté religieuse est non seulement un droit fondamental mais aussi« mais aussi un chemin vers la vérité et la communion plus profonde avec Dieu et le prochain ».
Presque 5,4 milliards de personnes vivent dans des régions qui rencontrent de graves violations de la liberté religieuse, selon le nouveau rapport publié le 21 octobre à Rome par l’Aide à l’Église en Détresse (AED). Publié tous les deux ans, il couvre 196 pays pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État, a commenté ce nouveau rapport ce mardi en rappelant que la liberté est non seulement un droit humain fondamental et essentiel, « mais aussi un chemin vers la vérité et la communion plus profonde avec Dieu et le prochain ».
Il a toutefois souligné que les « 5,4 milliards de personnes » affectées évoquées par le rapport représentent « presque les deux tiers de la population mondiale ». Le fait que le rapport 2025 couvre 1 248 pages, un record en 25 ans de publications, « indique que les violations de la liberté religieuse augmentent d’année en année », a-t-il ajouté en s’adressant aux journalistes.
Le rapport a constaté une situation « fortement restreinte » dans 62 pays sur 196, ainsi que « des violations graves et systémiques, dont des violences, des arrestations et des répressions qui affectent plus de 4,1 milliards de personnes, dans des nations comme la Chine, l’Inde, le Nigéria et la Corée du Nord ».
60 ans de Dignitatis Humanae
L’AED a également listé une série de 38 autres pays, dont le Vietnam, où les « discriminations religieuses » sont courantes. Selon la fondation, on trouve dans ces pays « des groupes religieux qui rencontrent des restrictions systématiques contre le culte, l’expression et l’égalité juridique ». « Bien qu’elles ne soient pas sujettes à la répression violente, ces discriminations entraînent souvent la marginalisation et l’inégalité juridique. »
En commentant le rapport, le cardinal Parolin a également évoqué le 60e anniversaire à venir de la déclaration Dignitatis Humanae du concile Vatican II sur la liberté religieuse, en expliquant que sur le plan personnel, la liberté religieuse « protège le sanctuaire intérieur de la conscience, la boussole qui vient de Dieu et qui guide les choix éthiques et spirituels ».
Il a ajouté que sur le plan collectif, la liberté religieuse « favorise des communautés vivantes où des personnes de différentes confessions peuvent vivre ensemble, contribuer à la société et s’engager dans un dialogue constructif sans crainte de persécution ». Le rapport 2025 a conclu que « le nationalisme religieux est en hausse, et alimente l’exclusion et la répression des minorités », a-t-il déploré. « L’identité nationale est de plus en plus façonnée par le nationalisme ethnoreligieux, en excluant les droits des minorités. »
Des signes d’amélioration en Chine
Une situation que l’on retrouve par exemple « en Inde et en Birmanie », ou le nationalisme religieux « entraîne des persécutions », et « en Palestine, en Israël, au Sri Lanka et au Népal, où il alimente des discriminations » (le Sri Lanka fait cependant partie des pays où la situation s’est améliorée durant la période étudiée).
Par ailleurs, selon le rapport, « les persécutions religieuses provoquent de plus en plus de migrations et de déplacements forcés », avec des victimes à travers le monde qui fuient « les violences, les discriminations et l’absence de protection d’État ». Le rapport a également vu dans l’Accord provisoire Chine-Vatican signé en 2018 un « signe d’amélioration » pour les chrétiens chinois, tout en notant que cette amélioration ne s’est appliquée qu’aux chrétiens appartenant aux organisations reconnues par Pékin.
Ainsi, ajoute le rapport, des prêtres et évêques chinois ont continué d’être arrêtés ou détenus pour avoir refusé de rejoindre l’Association patriotique des catholiques chinois, et dans de nombreuses régions de Chine, toute personne de moins de 18 ans est interdite d’assister à un événement ecclésial ou paroissial.
En Asie, l’expression religieuse est vue de plus en plus comme une menace
De manière générale, sur tout le continent asiatique, le rapport note que « l’expression religieuse est de plus en vue comme une menace envers la sécurité de l’État ou l’identité nationale », alors que de nombreux gouvernements renforcent leur contrôle et que les groupes extrémistes étendent leur influence.
Une situation que l’on retrouve en Inde, ou « les politiques nationalistes hindoues sous le parti BJP ont constamment érodé les protections constitutionnelles », les chrétiens ayant subi « au moins 834 attaques rien qu’en 2024 ». En Birmanie, le rapport parle d’une répression hybride, c’est-à-dire à la fois politique mais aussi visant l’identité ethnique et l’affiliation religieuse.
Au Pakistan, le rapport explique qu’on continue d’enregistrer « des enlèvements, conversions forcées et mariages forcés impliquant des filles hindoues et chrétiennes – parfois de seulement 10 ans – en toute impunité ».
L’AED souligne que l’Asie est devenue « une scène cruciale où l’autoritarisme et l’extrémisme s’entrecroisent », avec des gouvernements comme en Chine, en Iran ou au Vietnam qui répriment la vie religieuse via « des surveillances invasives, des législations restrictives et une répression des convictions dissidentes ».
« Malgré les persécutions, les communautés religieuses continuent de faire preuve d’une résilience remarquable, et s’engagent activement dans la construction de la paix et dans la distribution d’aides humanitaires essentielles », ajoute le rapport, qui appelle à la solidarité mondiale : « Exposer la vérité sur les violations est le premier pas vers le changement. Ce n’est pas suffisant de se lamenter sur les injustices, il faut les exposer. »
Le 10 octobre, le pape Léon XIV a également reçu une délégation de l’AED avant la publication du rapport, qu’il a salué non seulement comme un outil formidable de sensibilisation et d’information depuis 25 ans, mais aussi parce qu’il « porte témoignage, donne la voix aux sans-voix et révèle les souffrances cachées de beaucoup ».
Sources : Ucanews, Asianews, Vatican News