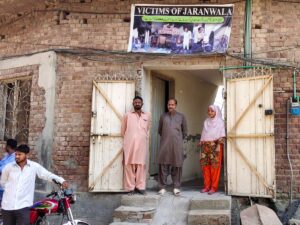Ryad, Washington, Pékin, Téhéran : les ressorts surprenants de la diplomatie pakistanaise
 Des gardes-frontières chinois et pakistanais au col de Khunjerab, frontalier entre la région du Xinjiang et le nord du Pakistan, dans les montagnes du Karakoram.
© Anthony Maw/CC BY-SA 3.0
Des gardes-frontières chinois et pakistanais au col de Khunjerab, frontalier entre la région du Xinjiang et le nord du Pakistan, dans les montagnes du Karakoram.
© Anthony Maw/CC BY-SA 3.0
Rédigé par Olivier Guillard, le 02/10/2025
Entre la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Iran et les États-Unis, le Pakistan multiplie les rapprochements diplomatiques et militaires. Tandis que l’armée, emmenée par l’omniprésent Field Marshal Asim Munir, s’affirme comme l’acteur central de la scène politique, Islamabad surprend en scellant un accord stratégique inédit avec l’Arabie saoudite. Un activisme international qui, s’il renforce certains partenariats, risque aussi de raviver les tensions avec l’Inde et de fragiliser encore une démocratie pakistanaise déjà vacillante. Par le géopolitologue Olivier Guillard.
Bien sûr, pour importantes soient-elles, les récentes interactions entre les principaux responsables pakistanais de premier plan et leurs homologues chinois ne prendront guère de court les observateurs du sous-continent indien :
- Le 15 septembre dernier, le président pakistanais Asif Ali Zardari (veuf de Benazir Bhutto[1]) s’est rendu dans la ville chinoise de Chengdu, capitale provinciale du Sichuan, afin de rendre visite au principal avionneur militaire chinois.
- Deux semaines auparavant, le 2 septembre, a également eu lieu la première rencontre à Pékin entre le président chinois Xi Jinping et le Field Marshal Asim Munir (chef des armées du Pakistan).
- Enfin, le 22 août puis à nouveau le 5 septembre, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s’est aussi rendu dans la capitale chinoise.
On pourrait citer les principaux responsables pakistanais ainsi, par ordre d’importance et d’influence à l’été 2025 : le patron des armées A. Munir, le Premier ministre S. Sharif et le président A. A. Zardari.
Ces dernières rencontres avec la Chine s’inscrivent dans une trame bilatérale étroite, connue de tous et de toutes, nourrie en permanence, établie de longue date. Une problématique familière et routinière, en quelque sorte.

Accord de défense stratégique mutuelle Arabie Saoudite – Pakistan
En revanche, la conclusion, le 17 septembre dernier, de l’accord de défense stratégique mutuelle entre le Pakistan et l’Arabie saoudite, paraphée lors de la visite à Ryad du chef de gouvernement pakistanais, est assurément plus surprenante pour le lecteur.
Cette rencontre a eu lieu nécessairement, entre autres, en présence du chef des armées, le désormais incontournable A. Munir, que l’on dit rêver à terme d’un « destin présidentiel », à l’image de divers pairs généraux avant lui (Ayub Khan de 1958 à 1969 ; Yahya Khan de 1969 à 1971 ; Zia-ul-Haq de 1977 à 1988 ; et enfin Pervaiz Musharraf de 1999 à 2008).
Cette signature est intervenue – pour mémoire – une semaine après les frappes menées à Doha (Qatar) par l’armée israélienne, ciblant des responsables du Hamas… Il s’agit du premier accord stratégique du genre entre une pétromonarchie du Golfe Persique et la seule nation atomique (militaire) musulmane du concert des nations.
Un partenariat ad hoc, entre deux acteurs entretenant un historique solide de coopération militaire (cf. le déploiement de troupes pakistanaises dans le royaume dans les années 1960 ; l’intervention en 1979 de commandos pakistanais lors du siège de la Grande mosquée de La Mecque ; l’alignementde Ryad sur Islamabad lors des conflits indo-pakistanais de 1965 et 1971, etc.). Sans compter les liens économiques (cf. de multiples assistances économiques et financières d’urgence du Royaume à la République islamique du Pakistan, etc.). Tous deux sont considérés par ailleurs – à des niveaux divers – comme des « alliés stratégiques » des États-Unis ; si le concept conserve aujourd’hui encore quelque sens.
Notons ici également à toutes fins utiles que Ryad entretient parallèlement avec l’Inde d’étroits rapports multidimensionnels (visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Ryad au printemps 2025) : l’Inde est par exemple le deuxième partenaire commercial du royaume et un client substantiel du brut saoudien, alimentant la désormais très dynamique et énergivore quatrième économie mondiale…
Un Field Marshal (chef des armées) itinérant[2]
Au registre des épisodes diplomatiques pakistanais récents de nature à interpeller l’observateur, évoquons ici en quelques mots le déplacement d’Asim Munir à Téhéran (Iran) le 27 mai, officiellement selon Islamabad « pour discuter de l’approfondissement de la coopération en matière de défense et de l’amélioration des mécanismes de sécurité aux frontières ».
Une visite tout sauf anodine dans le contexte volatile du moment. Quelques semaines plus tard, le 18 juin, les forces israéliennes engageaient une opération audacieuse visant le cœur des infrastructures nucléaires et militaires de la République islamique d’Iran, Tel Aviv défendant son initiative en affirmant que ces frappes étaient nécessaires et avaient pour dessein d’impacter significativement les avancées du programme atomique iranien. Téhéran a riposté en ordonnant le tir de salves de missiles balistiques sur Israël.
Les 24 au 26 septembre, les plus hautes autorités militaires (Field Marshal Asim Munir) et civiles (Premier ministre S. Sharif) pakistanaises étaient donc à nouveau invitées sur le sol américain. Notamment à New York (allocution du chef de gouvernement à la tribune de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU) mais également à Washington, destination visiblement prisée du patron des armées pakistanaises, après ses récentes visites de juin (trois semaines à peine après le dernier conflit en date avec l’Inde) et d’août 2025…
Ce néo-globetrotter en uniforme est visiblement très apprécié du locataire actuel de la Maison Blanche, et ne tarit pas d’éloges à son propos. Le fait que l’ancien et éphémère (octobre 2018 à juin 2019) patron des services de renseignements pakistanais (Inter-Services Intelligence ou ISI) d’Islamabad ait suggéré que le Prix Nobel de la paix 2025 soit décerné au chef de l’exécutif américain doit certainement y être pour quelque chose.

Islamabad – Washington, l’improbable lune de miel
Depuis la Maison Blanche où l’a reçu D. Trump le 25 septembre, le 20e Premier ministre pakistanais (aux affaires depuis mars 2024), a aussi « invité » les entreprises US à investir dans son pays dans divers secteurs prioritaires (agriculture, technologie, mines, énergie), se disant convaincu que, « sous la direction du président Trump, le partenariat entre le Pakistan et les États-Unis serait encore renforcé, dans l’intérêt mutuel des deux pays »[3]. Le président américain, en amont de cette réunion, a quant à lui présenté le Field Marshal Munir – en costume civil – comme « un type formidable, tout comme le Premier ministre ». Passons.
Il s’agit en tout cas d’un improbable retournement de circonstance, quand on se souvient que sous l’administration démocrate précédente (2017-2021), le Pakistan n’apparaissait guère sur les écrans de la présidence Biden, aucun responsable (à plus fortement militaire) pakistanais n’étant convié alors à Washington, ni même pris au téléphone.
De cette configuration diplomatique somme toute relativement inédite pour Islamabad, on peut notamment faire ressortir sommairement les quelques points (surprenants) suivants :
- Au printemps dernier (début mai) se déroulait le dernier épisode en date des conflits indo-pakistanais ; un chapitre d’une grande tension qui avait pour origine l’attaque perpétrée quinze jours plus tôt au Cachemire indien (Pahalgam) contre des civils (17 morts) par un commando terroriste a priori originaire du Pakistan.
- Déjà pour le moins sinistrée, la démocratie pakistanaise, familière contre son gré des coups d’État militaire à répétition, observe impuissante la énième montée en puissance et en influence d’un général ne faisant guère mystère de ses ambitions politiques et de son hostilité vis-à-vis du voisin indien.
- Reçu à plusieurs reprises – avec égards et compliments du locataire de la Maison Blanche – ces derniers mois au siège du pouvoir américain, le Field Marshal A. Munir joue déjà un rôle dépassant très largement (y compris géopolitiquement) le champ de ses compétences ; notamment sur l’échiquier diplomatique international.
De quoi légitimement interpeller sinon saisir les observateurs ; mais également s’inquiéter pour la gouvernance (déjà passablement corrompue[4]) pakistanaise à venir et laisser craindre de fort probables tensions futures entre Islamabad et New Delhi. Voilà qui n’augure rien de bon pour la déjà très ténue stabilité régionale.
(Ad Extra, Olivier Guillard)
[1] La défunte Première ministre assassinée dans des circonstances toujours mal « établies » en 2007 à Rawalpindi, symbole s’il en est de l’autorité militaire au Pakistan.
[2] Déplacement d’Asim Munir au Sri Lanka, en Indonésie puis en Chine (juillet 2025), en Turquie et en Iran (fin mai 2025), en Arabie Saoudite (17 septembre 2025), ou encore en Belgique (août 2025).
[3] Reuters, le 26 septembre 2025.
[4] Le Pakistan figure au 135e rang des 180 pays pris en compte dans le classement annuel Corruption Perceptions Index 2024 de Transparency International.